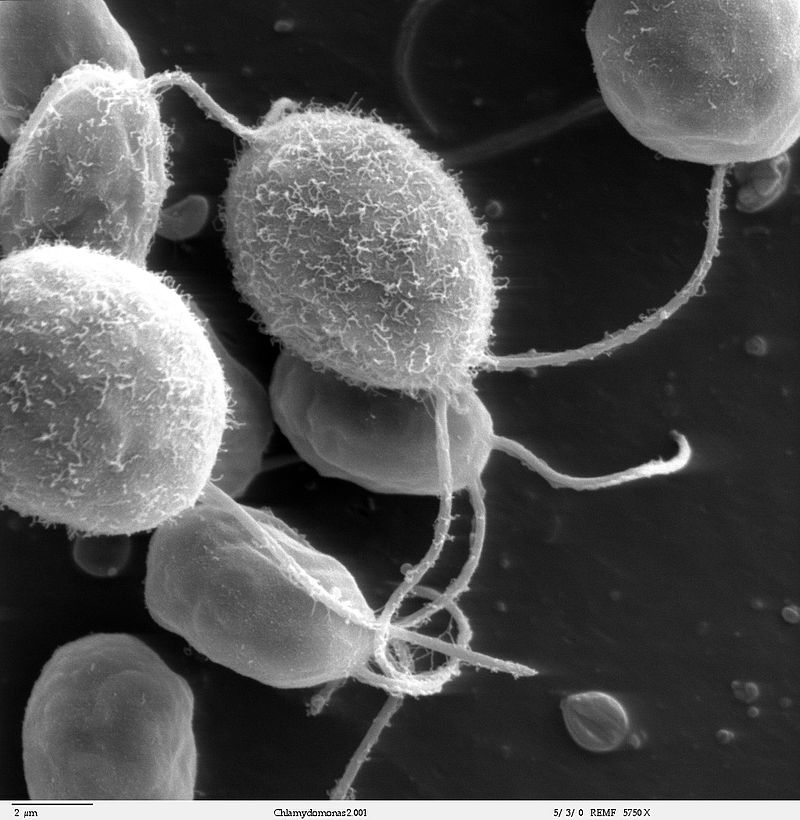Bienvenue au laboratoire Crémazy
Notre laboratoire étudie les impacts des métaux traces dans l’environnement aquatique et leurs effets aux niveaux moléculaire, individuel et écosystémique. Nous menons des études en laboratoire et sur le terrain, dans des climats tempérés à tropicaux, dans le but de comprendre comment les facteurs biotiques et abiotiques contrôlent la biodisponibilité des métaux et la sensibilité des espèces. Ces recherches fournissent de l’information essentielle permettant de mieux évaluer le risque écologique des métaux dans l’écosystème aquatique.
Nous sommes situés au Centre Eau Terre Environnement de l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS).
Adresse : 490 rue de la Couronne, Québec (Québec), G1K 9A9, Canada
E-mail : anne.cremazy@inrs.ca
Téléphone : +1 418 654-2640